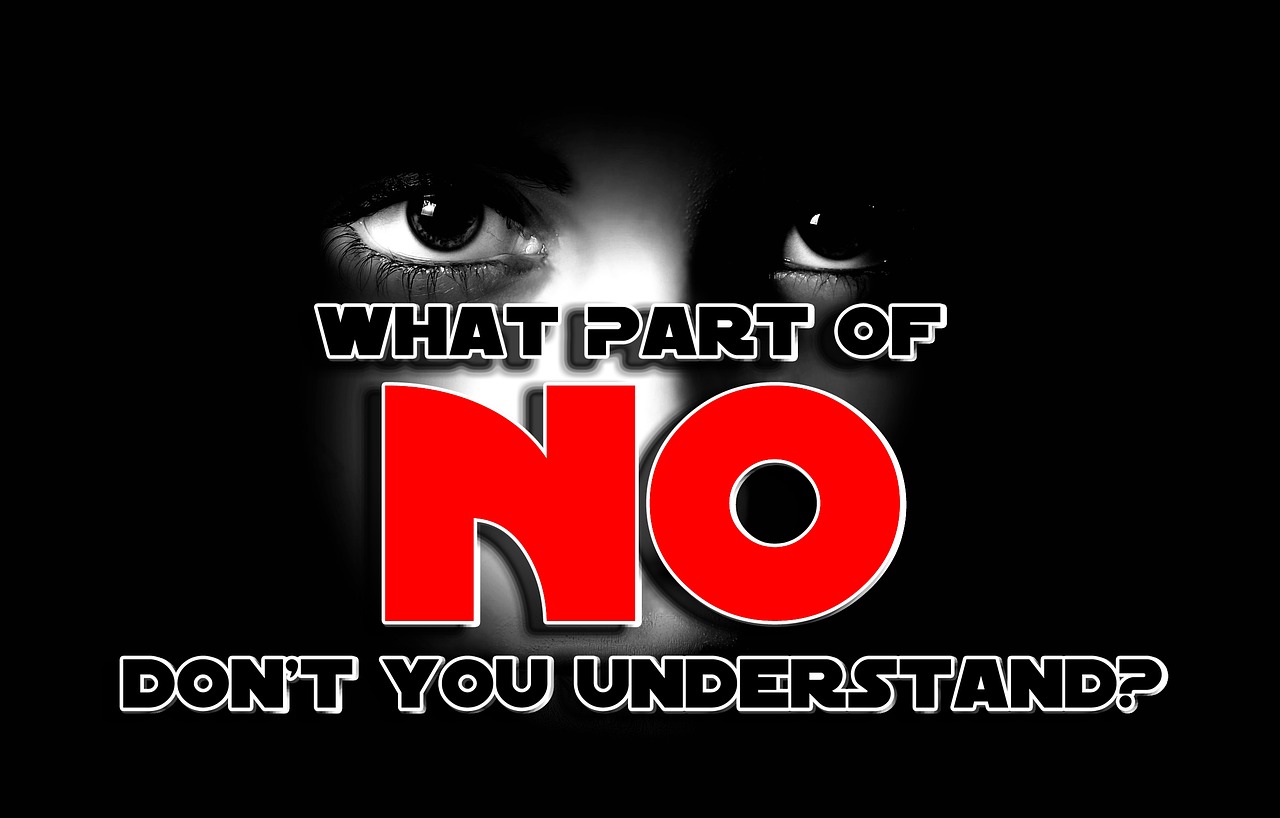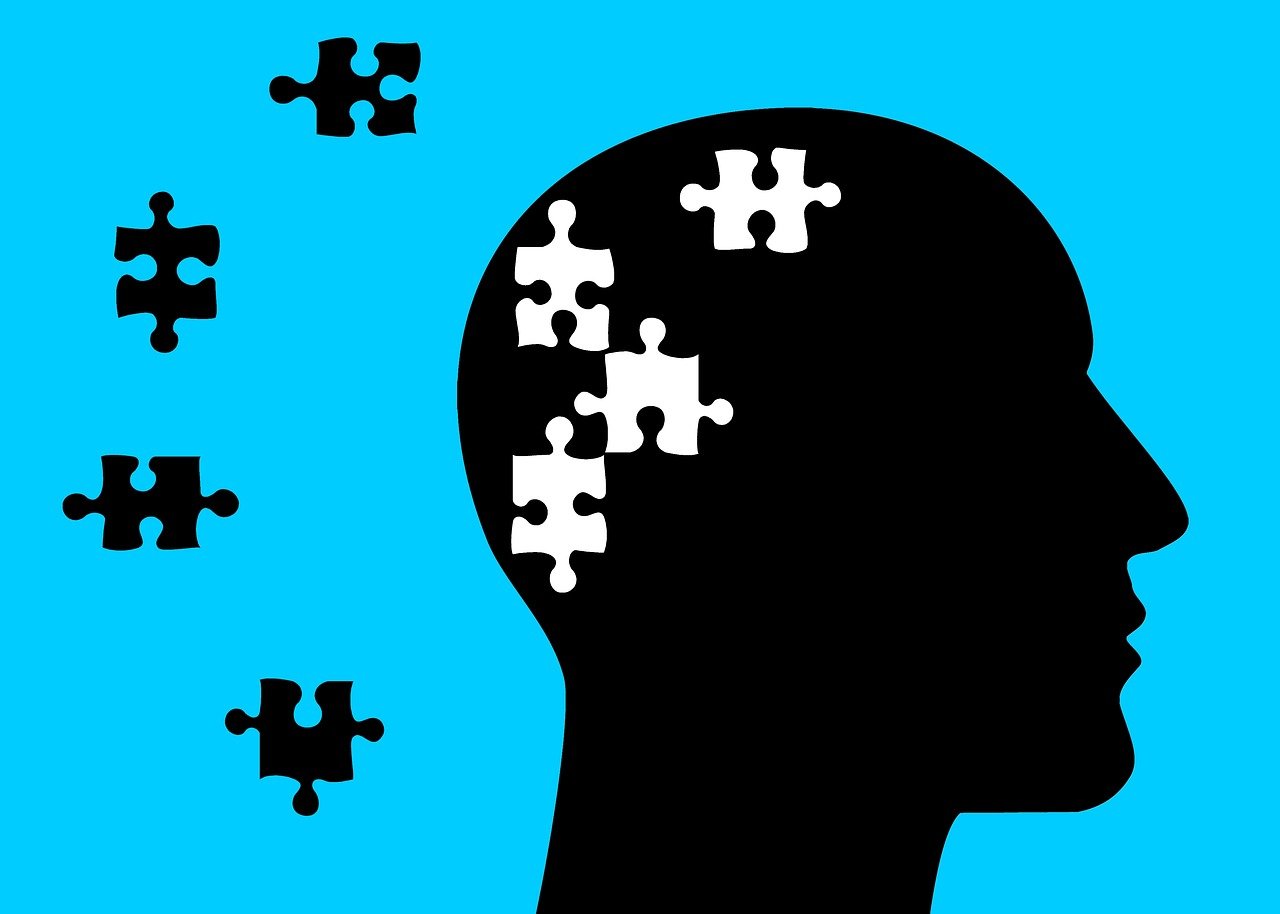L’asexualité : comprendre ce phénomène et les témoignages qui l’accompagnent
Dans un monde où la sexualité occupe une place prédominante, l’asexualité demeure un sujet méconnu pour beaucoup. Cet article a pour objectif de vous éclairer sur ce qu’est l’asexualité et de partager des témoignages de personnes concernées par cette orientation. Qu’est-ce que l’asexualité ? L’asexualité est une orientation sexuelle qui se caractérise par l’absence d’attraction … Lire plus